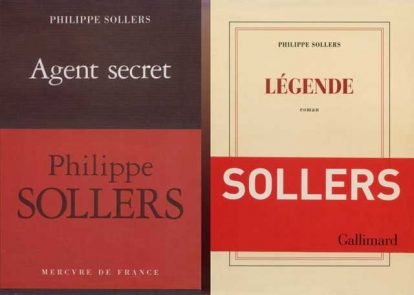 Sollers, les secrets d’une légende
Sollers, les secrets d’une légende
Philippe Sollers, Légende, Gallimard, 128 p., 12,50 €
Philippe Sollers, Agent secret, Mercure de France, 200 p., 18 €
Cela fait longtemps que Philippe Sollers tisse sa légende. À coups de provocations, d’articles brillants, de livres publiés à un rythme effréné ; il charge, fonce, prend tout le monde de vitesse, se rit de tout et surtout de lui-même, tout en arborant, avec une jubilation non dissimulée, une ironie permanente. Pourquoi cette galopade infernale ? Pour faire parler de lui ? Par excès de narcissisme ? Non, pour brouiller les pistes. Par goût du jeu, mais aussi de la dissimulation, Sollers est un agent secret ; quand il occupe le terrain, c’est pour mieux disparaître.
Il met en garde cependant, l’on doit être l’agent secret de sa propre vie et sûrement pas pour le compte d’un État. « L’éloge de la contradiction, c’est mon sujet. Car, en tant qu’agent secret, je me dissimule, je me mets à l’écart. […] Pleinement engagé, pleinement à l’écart. » Il n’y a qu’un seul moyen de le connaître, le lire. Et ça, c’est une autre affaire, c’est un merveilleux, un infini voyage car Sollers écrit une manière d’être au monde. « Un père doit affirmer son autorité, un fils s’échappera le plus possible. » Cette phrase, extraite de Légende, dit beaucoup du jeune homme auteur d’Une curieuse solitude, premier roman salué par Mauriac et Aragon en 1958 et dont l’exergue, « Le plus beau des courages, celui d’être heureux », semble avoir décidé d’une vie tout entière consacrée à la littérature et à la liberté ; elle parle aussi de l’éditeur, parrain de livres passionnants dans la collection « L’Infini ». Sollers est infatigable et il se paye le luxe d’être encore sulfureux et souvent détesté à 84 ans.
Pourquoi détesté ? On se le demande… En jésuite qu’il a été à 17 ans à Versailles, il sait poser des questions. Ainsi dans Légende : « Un monde sans père serait peut être pacifié et anesthésié, mais pourrait aussi devenir d’un ennui mortel. Où est passé le Méchant, le Prédateur, l’Agresseur, le Violeur, le Tueur, l’Emmerdeur, l’Inapproprié par excellence ? Que faire sans l’animateur d’une détestation cadrée ? » Sollers est sans illusion.
Dans Agent secret, il cite le « Révérend père Lacan » à propos de la forclusion du Nom du Père : « Là, je vais suivre Lacan à la lettre : ça entraîne tout simplement la psychose. Le Père, ça n’est pas le géniteur, le Père, c’est un nom. Et qu’est-ce que devient le nom ? Encore une fois : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l’a dit l’Église catholique en martelant ça sans arrêt. Et Je vous salue Marie pleine de grâce… C’est une architecture sublime qui a donné lieu à une série invraisemblable de chefs-d’œuvre dans tous les domaines. Voilà en quoi je crois. »
Quelques pages plus loin, il écrit ces mots bouleversants : « Voici la photo d’un innocent que j’aime. C’est mon fils David. Ici, il a six ou sept ans. […] L’expérience de la paternité a été pour moi capitale, la naissance de cet enfant a été un bonheur incroyable. J’ai senti pour la première fois que j’étais mort, ce qui m’a beaucoup soulagé. »
Lire Sollers c’est lire quelqu’un qui est là, qui ne craint pas la mort et qui vit comme personne.
Jean-François Rouzières
 De la complexité des choses
De la complexité des choses
Jean Birnbaum, Le Courage de la nuance, Le Seuil, 144 p., 14 €
Tout est bon dans le dernier livre de Jean Birnbaum, Le Courage de la nuance ; tout, sauf peut-être le titre : non pas l’appel au courage, bien sûr, mais la célébration de la nuance, qui donne le sentiment d’un entre-deux, d’un « en même temps », d’un clair-obscur sans consistance ; certes, il s’agit pour lui de dénoncer les méfaits des débats manichéens, des dualismes simplificateurs qui décrivent la réalité en blanc et en noir ; mais, qu’on ne s’y méprenne pas, l’auteur ne leur substitue pas les innombrables nuances de gris que peuvent produire le mélange de ces deux couleurs extrêmes.
En fait, ce que recouvre pour lui le mot nuance, c’est ce qu’on appelle la complexité des choses, qui peut conduire à ce que des interprétations contradictoires soient également vraies. La nuance, pour l’auteur, ce n’est pas le gris, c’est la coexistence du blanc et du noir. Alors, va pour la nuance, si c’est ce qu’elle veut dire. Et, de Raymond Aron à Roland Barthes en passant par Germaine Tillion, d’Hannah Arendt à George Orwell en passant par Georges Bernanos, ce sont, en commençant bien sûr par Albert Camus, sept auteurs qu’il convoque pour explorer les différentes facettes de cette nuance dont il nous fait l’éloge : des « spectateurs engagés », selon la belle formule de Raymond Aron, et pour qui la nuance, c’était d’abord de penser contre soi-même pour ne pas être prisonnier de son camp.
En interlude entre les chapitres de son ouvrage, il livre une sorte d’ordonnance, énonçant ainsi la liste des remèdes à l’outrance des débats : bien nommer les choses, prendre le parti de la franchise, pratiquer l’humour, se sevrer de la dépendance à la crainte de « faire le jeu de l’adversaire », avoir conscience de la part d’inconscient qui nous anime, et enfin s’adonner sans réserve à la littérature et la poésie. Tout un programme !
Daniel Lenoir
 Tic-tac
Tic-tac
Anne-Marie Mitchell, La Pendule d’argent, Karbel Éditions, 240 p., 18 €
On connaît le talent singulier d’Anne-Marie Mitchell, amoureuse des chats en particulier, de la gent animale en général, et romancière inspirée, dans le genre inclassable. La Pendule d’argent ne déroge pas à ce goût des formes libres : un style à sauts et à gambades, comme disait Montaigne, peu soucieux des codes littéraires répertoriés, qui réserve quelques belles surprises : digressions, commentaires furibonds ou attendris sur la vacherie du monde et le triomphe des fausses valeurs, souvenirs lumineux. La Pendule d’argent, c’est celle des Vieux de Jacques Brel, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non et puis qui nous attend. Cette chanson, largement citée, est le fil rouge de ce roman, ou plutôt de cette chronique de vies qui ont traversé presque tout un siècle.
Marinella, Savinien et Puccettino, pour ne citer qu’eux, personnages sur le dernier versant de l’âge, prennent tour à tour la parole, avant que l’auteur, leur porte-parole et peut-être aussi un peu chacun d’entre eux, n’apporte en conclusion son propre grain de sel. Ils racontent leur vie ou ce qui mérite à leurs yeux d’en être retenu, croisent leurs expériences, leurs amours, comme au débotté, dans une confession chorale où se mêlent les souvenirs, les affections artistiques et littéraires, l’amour des animaux et parfois des humains, et aussi quelques coups de griffes. Des griffes de chat, bien sûr. Leurs vies, comme toutes les vies, furent une farce autant qu’une tragédie. Et un trésor de rencontres, virtuelles surtout, imaginaires souvent, avec ces artistes et ces oeuvres de toutes sortes qui nous accompagnent et nous aident à vivre. Privilège suprême du grand âge, plus rien ne les retient de dire ce qu’ils pensent de l’époque foutraque qu’ils ont traversée. Marinella, Savinien et Puccettino se retrouvent au cimetière le 3 janvier 2028. Morts, évidemment. On ne cherchera pas dans leurs libres confidences d’outre-tombe, où les souvenirs se bousculent, une intrigue artificiellement troussée, plutôt les ultimes étincelles de vies qui s’achèvent. Livre drôle, touchant et, paradoxe, indéfectiblement vivant.
Bernard Fauconnier
 Re-pères
Re-pères
Jean-François Rouzières, D’un fils d’alligator et d’une fille d’esclave, Et le bruit de ses talons Éditeur, 164 p., 17 €
Avec D’un fils d’alligator et d’une fille d’esclave, le psychanalyste Jean-François Rouzières – contributeur de Témoignage chrétien – nous offre un magnifique roman, empreint de vérité et de passion, et nous narre l’impossible mais néanmoins certain et nécessaire passage de l’enfance à l’âge adulte. Deux adolescents, Tom et Adèle, vont s’aimer, s’aider, se déchirer, se trouver, se retrouver en un long combat qui captive et fascine le lecteur.
On retrouve là des thèmes (t’aime ?) qui sont chers (chair ?) à l’auteur. Dans son premier roman, Le Revolver de Lacan, Jean-François Rouzières ciblait déjà la guerre et ses soldats comme image réelle et fantasmée de l’avènement de la vie. Ses personnages, dans ce second roman, ont une épaisseur, une psyché, une réalité que seuls les grands romanciers parviennent à faire vivre par les mots à travers les maux qui les submergent. Alors, bien sûr, le sang irrigue le récit pour faire palpiter les cœurs, qui très tôt dépassent l’innocence de l’enfance.
Et l’âme humaine comme animale s’y dévoile lentement pour n’être (naître ?) plus soumise à la toute-puissance du père alligator, ou esclave, qu’importe ; la castration symbolique y est décrite avec une acuité qui fait frémir. Et le sexe, sans lequel la vie serait inconcevable, y fait figure de mort, comme ces serpents qu’Adèle collectionne en secret (se créent ?).
Et c’est bien une nouvelle création que l’amour de Tom et Adèle engendre dans le sang et le sexe. L’auteur connaît les tréfonds de l’inconscient ; Tom et Adèle, sous sa plume, existent dans leur dimension psychique et corporelle. Le rythme est passionnant, l’écriture prenante dans sa pudique violence. On tremble pour ces deux êtres tout au long de leur parcours initiatique dans le labyrinthe de l’adolescence, subtilement décrit, au propre comme au figuré. Leur repaire (re-père ?) est fait d’escaliers dérobés, de chambres secrètes, d’illusions d’optiques et de postes de commandement comme d’enfermement. Le lecteur se passionne pour ces tours et détours tellement réels, douloureux, sublimes. Le messager qui apporte la lettre (du roman ?) est aussi celui qui porte l’amère (la mère ?) banalité du désir interdit ; il en mourra dans une scène grandiose et épique (et pique ?).
L’imaginaire rejoint la bête réalité – et les bêtes : cheval, chien, vipère… y vivent réellement. Un très beau roman, plein de poésie et de fureur, de tendresse et de brutalité, de délicatesse et de force. Une force qu’acquièrent ces deux adultes-enfants, qui, avec les mots exquis et percutants de Jean-François Rouzières, parviennent à un autre engendrement de la vie.
Bertrand Rivière
 Laïcité de 1905 à nos jours
Laïcité de 1905 à nos jours
Patrick Weil, De la laïcité en France, Grasset, 164 p., 14 €
On le sait, l’histoire ne se répète, ni ne bégaie ; en revanche, il est possible de trouver dans le passé, sinon des concordances, du moins des résonances avec les sujets d’aujourd’hui. Ainsi, la façon dont les débats qui ont précédé et suivi la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État résonnent avec les nôtres est au coeur du dernier livre de Patrick Weil. Un détour par l’histoire qui permet aussi de soigner la « polarisation mortifère » des débats sur la laïcité. On peut aussi dégager de ce « moment 1905 » des leçons à l’usage d’un exécutif qui se comporte avec la laïcité comme un gallinacé qui aurait trouvé un couteau suisse.
Il n’est pas inutile de se souvenir que la laïcité n’est pas née avec la loi de 1905, mais s’est imposée à l’issue d’un long processus qui a commencé dès le début de la IIIe République – quand elle se fut affranchie des tentations monarchistes et versaillaises – et qui lui-même plonge ses racines dans les valeurs issues de la Révolution française, avec l’affirmation des libertés de conscience et d’expression. La loi de 1905 est le résultat de la conjonction d’un travail préparatoire approfondi et largement consensuel.
Malgré cela, elle s’est trouvée confrontée à une opposition de principe d’un pape qui « ne [concevait] qu’un seul type d’État, catholique [et] rendant un “culte public à Dieu” ». Rappelons à ce sujet que l’Église romaine n’a jamais accepté le cadre démocratique des associations cultuelles posé par la loi de 1905 et a tenté, avec le régime de l’État français, de rétablir son imperium sur les consciences. Ce n’est qu’après la Libération que les catholiques, du moins ceux qui s’étaient illustrés dans la Résistance, se sont réellement ralliés à la laïcité, qui est devenue à ce moment-là principe constitutionnel, et ce n’est qu’avec Vatican II, soixante ans après la loi de 1905, que l’institution elle-même en a réellement accepté les principes.
Il y a bien d’autres choses intéressantes dans ce livre, notamment sur la place des cultes dans l’espace public, ou, au-delà des sensibilités différentes, sur la proximité juridique entre la France et les États-Unis, qui sont toutefois davantage connues. Sa lecture est en tout cas des plus utiles pour aborder les débats d’aujourd’hui, non pour transposer les solutions de l’époque, mais pour s’en inspirer, même si c’est avec une autre religion, l’islam, et dans une société profondément sécularisée.
Daniel Lenoir
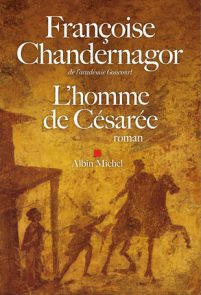 Sur les traces d’une autre Cléopâtre…
Sur les traces d’une autre Cléopâtre…
Françoise Chandernagor, L’Homme de Césarée, Albin Michel, 432 p., 22,90 €
Fille de Cléopâtre et du général Marc-Antoine, concurrent malheureux d’Auguste pour le pouvoir suprême à Rome et en Méditerranée, Séléné est une reine oubliée. Sauf par Françoise Chandernagor.
Elle avait déjà raconté l’enfance et l’adolescence de la petite princesse d’Alexandrie dans ses deux romans précédents : Les Enfants d’Alexandrie, et Les Dames de Rome. Après la disparition des siens lors de la chute de Cléopâtre, Séléné est envoyée à Rome. Exhibée enfant lors du triomphe d’Octave, elle est ensuite élevée au sein même de la famille impériale par Octavie, sœur de César, comme une hôte de marque. Après une décennie de lutte contre la maladie et avec une énergie créatrice retrouvée, Françoise Chandernagor reprend enfin le fil de son récit : « Car il faut être en pleine forme pour infuser de son propre sang à cette momie égyptienne. Les êtres de papier, on le sait, se nourrissent du romancier… Si je ne leur donne pas un peu de ma chair et de mon sang, ils n’existeront pas. »
Avec L’Homme de Césarée nous voilà à nouveau au cœur d’un monde romain jeune, violent, courageux, indifférent à la mort et dépourvu de toute compassion. Bref, le monde antique d’avant la révolution chrétienne. Au fil des pages éclate la personnalité de l’époux que choisit l’empereur Auguste pour Séléné : « Je me suis enflammée pour son mari, Juba II, un Numide élevé à Rome après la défaite de son père face aux légions. Il était pétri de culture hellénistique. Il a régné sur la Mauritanie, les actuels Maroc et Algérie, tout en écrivant sur Rome, le théâtre, la peinture. C’était un excellent cavalier, un botaniste averti… » Juba sera aussi marin, lançant des expéditions maritimes le long des côtes africaines, jusqu’aux îles Canaries. Une vie sous le soleil de Césarée, capitale d’un royaume immense et riche, formé par le Maroc et l’Algérie. Et nous suivons Juba II jusqu’à son autre capitale, Volubilis, non loin de Meknès, dans le Maroc actuel, toujours à dicter en grec une œuvre littéraire, hélas perdue pour l’histoire…
Rome n’est pourtant jamais très loin. Avec le récit des combinaisons patrimoniales sans fin d’Auguste pour assurer sa descendance, mariant et divorçant sans cesse ses proches. Que ce soit son fidèle Agrippa, numéro deux du régime impérial, le futur empereur Tibère ou sa propre fille, Julie. Une vaste famille recomposée avant l’heure… Et si ce mariage improbable entre l’homme de Césarée et la fille de Cléopâtre restait la plus belle réussite matrimoniale d’Auguste César et de sa Pax Romana ?
Henri Lastenouse
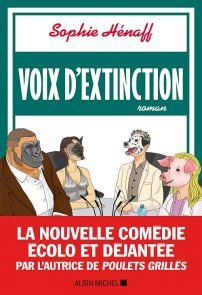 Animal, on est mal
Animal, on est mal
Sophie Hénaff, Voix d’extinction, Albin Michel, 368 p., 19,90 €
On est en 2031 et on est mal. Très mal, même. Les grandes espèces animales sont en voie de disparition et Martin Bénétant, vétérinaire généticien et accessoirement prix Nobel, se bat pour obtenir un traité international de protection de la nature. Mais le conclave avec le gratin de la planète qu’il a réussi à organiser semble voué à l’échec. C’est alors que Dieu décide de s’en mêler. La création, après tout, c’est son oeuvre, non ? Elle – ah oui, Dieu est une femme – convoque Noé et le charge de trouver une solution.
Il est décidé d’envoyer sur terre et au conclave quatre animaux – on n’est jamais si bien servi que par soi-même –, qui prendront forme et usages humains pour aller plaider leur cause. Sophie Hénaff s’était fait un nom avec ses polars déjantés mettant en scène une équipe de bras cassés. Elle quitte les commissariats pour livrer un portrait hilarant et désespérant de l’humanité confrontée à un de ses plus grands défis. Cléo la chatte, Rose la truie, Kombo le gorille et Bill le chien ont bien du mal à se hisser – ou s’abaisser – au niveau des humains. Chassez le naturel et observez l’étendue des dégâts qu’il fait en revenant au galop. Sous l’œil courroucé de Dieu, qui n’en revient pas que ses sbires aient laissé s’installer un tel désordre… et se voit même obligé de renvoyer sur terre un Gabriel qui proteste en vain.
Ce roman, qui se déguste comme une coupe de champagne, avec ses bulles de rire qui montent sans cesse au cerveau, n’en est pas moins extrêmement précis et documenté. Et il est vrai que, quand on prend conscience du volcan sur lequel nous dansons, c’est nettement moins drôle.
Sophie Bajos de Hérédia
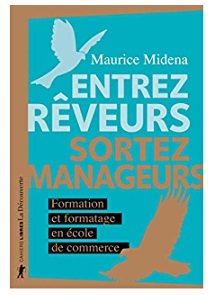 Le credo des business schools
Le credo des business schools
Maurice Midena, Entrez rêveurs, sortez manageurs. Formation et formatage en école de commerce, La Découverte, 309 p., 20 €
En mai 2018, une campagne publicitaire envahit les murs du métro parisien. “Entrez rêveur, sortez manager” : voilà la promesse de l’Inseec Business School. Maurice Midena, journaliste chez Arrêt sur images après avoir été pigiste pour Le Monde diplomatique, XXI ou Forbes, a pris au mot le slogan de l’école et en a fait le titre de son premier livre. Dans cette enquête très détaillée, appuyée des dizaines de témoignages d’étudiants ou anciens étudiants, des statistiques et travaux de chercheurs, il décrypte les désillusions des élites économiques de demain, « confrontées, de gré ou de force, à la réalité du marché du travail et happés par le carcan de l’idéologie néolibérale« . Un univers qu’il connaît bien pour avoir été un “étudiant d’école de commerce typique” à Audencia, à Nantes.
Ces écoles, nées au début du XIXe siècle à l’initiative de la bourgeoisie marchande, ont connu une montée en puissance depuis la seconde moitié des années 1980, avec le soutien, y compris financier, de l’État. Celui-ci en reconnaît officiellement vingt-six, aux frais de scolarité exorbitants, qui viennent grossir les rangs des cabinets de conseil, des instances dirigeantes du CAC 40 et, de plus en plus, de l’Assemblée nationale. Après l’épanouissement intellectuel de la classe préparatoire, les admis en école de commerce sont confrontés, d’après Maurice Midena, à la “défaite de la pensée”. Le terme le plus utilisé par les étudiants pour décrire les enseignements est celui de “bullshit” : en management des organisations ou en finance de marché, on apprend à accroître la rentabilité et limiter la masse salariale, à grand renfort de diaporamas PowerPoint et d’études de cas. L’investissement croissant dans la recherche et les discours sur la moralisation de l’économie n’y changent rien.
Derrière une dépolitisation de façade, ces business schools décourageraient la dissidence intellectuelle. “Nous, on parlait très peu politique, de toute manière les gens étaient plutôt libéraux, quoique y avait quelques personnes un peu perchées qui adhéraient pas trop, trop”, décrit une ancienne étudiante à Grenoble. Des “ouailles” biberonnés à l’ “orthodoxie” économique, des “réfractaires” recadrés : dans son ouvrage essentiel pour comprendre la fabrique du consentement au sein même de la future caste du marché, Maurice Midena multiplie les emprunts au lexique religieux pour décrire la “théologie du management” prêchée en école de commerce.
Timothée de Rauglaudre






